 |
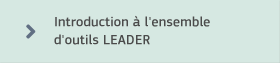 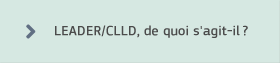 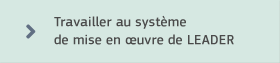 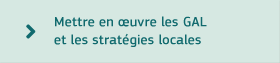 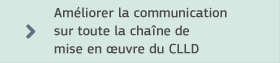 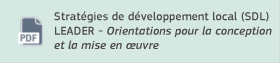 |
Pourquoi l’élaboration et la sélection efficaces de projets occupent-elles une place si importante dans le processus LEADER ? Il peut sembler évident que c’est en menant des activités de projet que les GAL atteignent leurs objectifs, mais c’est seulement grâce à un processus d’élaboration et de sélection de projets efficace que les GAL peuvent choisir et soutenir ceux à même de contribuer au mieux à la réalisation des objectifs de leur stratégie de développement local (SDL). Pour obtenir les résultats souhaités, il est donc nécessaire de choisir des projets adaptés.
La sélection de projets capables de réaliser la stratégie figure parmi les fonctions stratégiques les plus importantes des GAL. C’est pourquoi il est vital que cette étape soit soigneusement pensée et élaborée pour être en adéquation avec la SDL. Avant la décision de sélection à proprement parler, il y a quatre principaux éléments à considérer :
Le processus d’élaboration et d’animation de projet est un processus stratégique. La manière dont les projets sont élaborés peut avoir une grande influence sur le type et la qualité des projets proposés et leur capacité à mettre en œuvre les objectifs de votre stratégie de développement local. C’est pourquoi il importe que les GAL conçoivent et appliquent un processus d’élaboration de projets qui favorise et soutient les types de projets à même de réaliser leurs priorités.
Les critères d’évaluation doivent être définis dans les modalités de mise en œuvre de la stratégie de développement local ; ils doivent être cohérents et en lien direct avec l’analyse territoriale et la logique d’intervention de la stratégie de développement local, les objectifs SMART[1] et les indicateurs de suivi et d’évaluation proposés. Ceux-ci comprennent à la fois des critères techniques et qualitatifs.
Le processus d’évaluation doit être défini dans les mécanismes de gestion de la stratégie de développement local et conçu de manière à permettre de prendre en connaissance de cause des décisions objectives et mûrement réfléchies grâce à une procédure efficace et transparente. Par souci de transparence, les candidats potentiels doivent être en mesure de consulter les critères d’évaluation.
Veiller à la transparence de la procédure de candidature et de sélection est absolument capital pour entretenir la motivation et la confiance des acteurs locaux. Les procédures et critères de candidature et de prise de décision doivent être très clairement définis dans les documents de candidature et tout autre support promotionnel associé. Si possible, le personnel s’assure que ces documents sont bien compris. Si les procédures sont importantes en soi, leur mise en pratique l’est tout autant. Il est essentiel que les GAL tiennent leurs promesses et qu’ils en informent clairement les candidats.
Exemple d’Écosse (Royaume-Uni) : Programme en plusieurs étapes de soumission de candidature et de suivi continu de projets
Exemple de Grèce : Règles et méthodologies claires pour assurer l’implication de différents secteurs dans les stratégies locales
[1] Spécifié, mesurable, acceptable, réaliste, situé dans le temps (SMART) : P. Drucker
Une fois que le GAL a fait approuver sa stratégie de développement local et s’est mis au travail, l’étape suivante du processus d’élaboration est la préparation et la sélection de projets par lesquels cette stratégie sera mise en œuvre.
Comment les GAL peuvent-ils veiller à ce que des projets « adaptés » soient amorcés, élaborés et sélectionnés ; des projets qui non seulement seront cohérents avec les objectifs de la stratégie de développement local, mais qui contribueront également en grande partie à leur réalisation ? Comment les GAL peuvent-ils élaborer des projets performants ? Quels sont les points essentiels à prendre en compte ? Quels outils utiliser ?
À l’évidence, il est judicieux pour les GAL de « piloter » ce processus d’élaboration, d’encourager le type adapté de candidatures et de faire en sorte que ce processus donne lieu à des projets performants qui contribueront aux priorités de la stratégie de développement local.
Le contexte dans lequel les projets sont élaborés constitue le premier point que le GAL doit prendre en compte ; il est possible que la demande des projets ne corresponde pas nécessairement aux objectifs du GAL et à sa stratégie de développement local.
Il arrive qu’il y ait une forte demande de propositions ne correspondant pas à la stratégie de développement local ou à ses objectifs, par exemple, des projets mal adaptés ou trop généraux qui n’ont pas d’orientation stratégique ou qui ne se rapportent pas à la stratégie de développement local. Dans ce cas-là, le GAL doit travailler avec les candidats afin de les informer, de les encourager, de les guider, de les inciter à soumettre des propositions « adaptées » et de soutenir activement l’élaboration de ces dernières.
Il arrive qu’il y ait une pénurie de projets, en raison d’un manque de motivation ou de dynamisme, notamment dans un contexte économique difficile où les financements complémentaires sont rares. Le GAL peut alors relancer l’activité en soutenant le renforcement des capacités et en mettant en place des actions à « effet rapide », c’est-à-dire des petits projets capables de se traduire rapidement en actions et résultats pour relancer le dynamisme local.
Les meilleures idées peuvent être les plus difficiles à mettre en œuvre du point de vue des GAL comme des promoteurs de projets. Les projets innovants ont tendance à être plus ambitieux et plus complexes et peuvent être délicats pour les acteurs locaux. En effet, ils impliquent souvent des liens avec d’autres idées ou initiatives, de nouvelles connexions, de nouveaux contextes qui rendent la mise en œuvre plus complexe.
Communiquer la stratégie de développement local et ses objectifs et critères de sélection est par conséquent une activité d’animation clé pour les GAL, qui doivent générer des projets appropriés et de bonne qualité contribuant à la réalisation des objectifs.
Pour générer des projets, les GAL ont le choix entre deux approches principales : ils peuvent être soit proactifs, soit réactifs (même si en réalité, beaucoup choisissent une approche intermédiaire).
L’apport d’un soutien actif à l’élaboration de projets et aux acteurs du développement est une des principales différences entre LEADER et d’autres initiatives de développement territorial et les approches d’intégration plus conventionnelles. Il est donc préférable d’adopter une attitude proactive dans le cadre de l’approche globale, surtout en raison des effets positifs qu’elle a sur la qualité des projets en améliorant la connaissance de la stratégie de développement local et des types de projets recherchés, puis en accompagnant leur élaboration et leur mise en œuvre.
Toutefois, l’apport d’informations, aussi précieuses et nombreuses soient-elles, ne suffit pas toujours à engendrer des projets stratégiques solides. Cet aspect du processus LEADER requiert une gestion efficace, stratégique et proactive afin que des projets de bonne qualité puissent prendre forme. Outre des informations fiables et une communication efficace, les GAL ont à leur disposition plusieurs outils pour soutenir l’élaboration de projets stratégiques :
L’accompagnement lors de la phase de présélection est absolument déterminant, car il permet de garantir que les projets sélectionnés sont adaptés. Après tout, la raison d’être du développement local est de mener des projets performants qui aident à mettre en œuvre la stratégie de développement local.
Les GAL ont le choix entre deux grandes approches pour élaborer et sélectionner des propositions de projets :
Nous nous intéressons ici à la première approche, c’est-à-dire au classique appel à projets. Avant d’entreprendre un appel à projets, il est important que les GAL réfléchissent à la méthode la mieux adaptée à leur stratégie de développement local. Ils ont le choix entre :
Dans les deux premiers cas, les projets sont normalement sélectionnés selon les critères définis dans la stratégie de développement local, alors que dans le troisième cas, il est possible de modifier les critères entre deux appels afin de pouvoir répondre à l’évolution des besoins ou à des considérations budgétaires.
Quelle que soit la méthode choisie, il est conseillé d’opter pour un processus en deux étapes. Recourir en premier lieu à un appel à manifestation d’intérêt ou à une première demande de renseignements peut permettre d’éviter de perdre du temps et des moyens précieux en écartant les propositions inéligibles ou inadéquates.
À l’issue de cette première étape, les projets rejetés pourront être améliorés afin de mieux correspondre aux priorités de la stratégie de développement local ou être redirigés vers d’autres sources d’aide plus appropriées. Quant aux propositions de projet retenues, les dossiers constitués sont pour les GAL et leur personnel une précieuse source de renseignements leur permettant de nouer le dialogue avec les promoteurs de projet, puis de déployer l’aide et l’accompagnement afin d’élaborer la proposition complète.
Dans tous les cas, les GAL peuvent souhaiter cibler plus ou moins leurs appels, qui pourront ainsi viser :
Dans les deux derniers cas, il est important de tenir compte du principe de proportionnalité dans la prise de décision concernant les projets.
Les GAL appliquent deux principaux types de critères dans leur processus de prise de décision :
Lorsque le DLAL est mis en œuvre dans le cadre des autres Fonds ESI, il est nécessaire de mettre en place une coordination étroite entre ces fonds et la stratégie de développement local, ce qui demande une excellente harmonisation des critères d’éligibilité.
Avant d’accéder au stade de l’évaluation qualitative, tout projet doit répondre aux grands critères d’éligibilité au niveau du PDR. Ces critères portent généralement sur les activités, les bénéficiaires et les dépenses éligibles. Ces critères d’éligibilité sont normalement examinés lors d’une évaluation technique ; il n’existe pas de valeur seuil et la décision est définitive. Les éléments de cette évaluation sont examinés soit par l’autorité de gestion, soit par le GAL selon le système de mise en œuvre employé. Toutefois, la responsabilité finale de l’éligibilité revient dans tous les cas à l’AG.
Les critères d’éligibilité spécifiques de la stratégie de développement local ont tendance à être davantage associés à la manière dont la stratégie cible la zone géographique, les bénéficiaires ou les types d’activité soutenus. Ils sont normalement appliqués par le GAL afin de garantir la cohérence du projet avec la stratégie de développement local.
Il est important que les critères d’éligibilité soient appliqués aux projets le plus tôt possible dans le processus de candidature. Ils doivent clairement figurer sur les supports promotionnels et les documents de candidature afin que les règles soient connues de tous. Ils permettent ensuite de présélectionner les projets, idéalement lors d’un appel à manifestation d’intérêt ou d'une première étape de candidature. Cela évite de consacrer inutilement du temps à l’élaboration d’un projet et peut permettre de modifier les propositions, le cas échéant.
Les conseils et l’accompagnement offerts en continu pour soutenir l’élaboration des projets doivent veiller à ce que le dossier complet de candidature continue à respecter les paramètres d’éligibilité convenus ou que les éléments qui apparaîtront ultérieurement dans le processus d’élaboration (comme les permissions nécessaires) soient traités avant la soumission pour décision officielle.
La répartition des tâches entre le GAL et l’AG est claire. La responsabilité de l’évaluation qualitative des projets revient aux GAL, qui sont censés appliquer uniquement les critères de sélection de leur stratégie de développement local. L’AG ne peut pas imposer des critères de sélection de PDR supplémentaires après l’approbation de la stratégie de développement local, car de tels critères risquent d’influencer la décision définitive du GAL.
Le RPDC pour 2014-2020 stipule que les GAL doivent élaborer, définir et fixer les critères de sélection des projets spécifiques de leur stratégie de développement local. Les bonnes pratiques veulent aussi que les GAL fassent figurer leurs critères de sélection dans le plan d’action de leur stratégie de développement local. Ces critères de sélection doivent être adaptés aux spécificités de la zone et conçus pour déterminer si les propositions de projets non seulement concordent avec la stratégie, ses groupes cibles et ses objectifs, mais aussi y contribuent. Ils pourront être affinés plus tard lors d’appels à projets afin d’inclure des critères spécifiques d’un type d’activité, d’une zone ou d’un groupe cible.
Le processus décisionnel des GAL doit pouvoir s’appuyer sur ces critères, c’est-à-dire que ces derniers doivent permettre des avis qualitatifs et quantitatifs sur le bien-fondé des projets. Ces critères peuvent porter sur :
Pour permettre aux GAL d’émettre des avis objectifs, ces critères doivent impérativement être mesurables et se prêter à une utilisation répétée et régulière.
Exemple d’Irlande « Rendre les objectifs de la stratégie de développement local facilement mesurables »
Outre les avis sur le bien-fondé du projet du point de vue de sa contribution potentielle aux objectifs de la stratégie de développement local, il faut également envisager la capacité concrète du projet à produire des résultats. Pour cela, tout GAL doit mener un nouvel ensemble de vérifications pour lequel des critères devront être définis. Ces critères portent sur :
L’élaboration de critères de sélection spécifiques de la stratégie de développement local vise à optimiser le processus décisionnel permettant aux GAL de sélectionner et de financer correctement les projets qui seront les plus à même de contribuer à la réalisation de leurs priorités stratégiques, et ce d’une manière impartiale, cohérente et transparente. Par conséquent, ce processus et ces critères doivent être élaborés en conjonction et en coordination avec la stratégie de développement local et le plan de mise en œuvre qui y est associé. De plus, les critères doivent être approuvés par le GAL avant leur soumission et leur application.
Le recours judicieux à une manifestation d’intérêt ou à un processus de présélection permet largement de rationaliser le processus décisionnel, d’où la nécessité d’avoir à ce stade-là des critères clairs. Ces derniers consistent généralement en un sous-ensemble simplifié des critères de sélection ; ils permettent aux GAL de présélectionner des propositions, de donner un retour d’information et de renseigner sur l’élaboration du projet et le soutien prévu.
Les critères de sélection spécifiques de la stratégie de développement local recouvrent normalement au minimum les points suivants :
Pour une conception efficace du processus et des critères de sélection, il est utile de déléguer cette activité à un sous-groupe du GAL.
Lors de l’élaboration des critères de sélection de la stratégie de développement local, les GAL ont tout intérêt à tenir compte de la variété de types et d’échelles des projets et des candidats, ainsi que des différents niveaux du soutien financier recherché. Ce point est extrêmement important pour les actions ou les bénéficiaires à petite échelle, car si une exigence est trop élevée, elle risque de l’emporter sur les avantages potentiels et de s’avérer dissuasive. Cette prise en compte doit évidemment être contrebalancée par une grande rigueur et une obligation de rendre des comptes.
Les critères doivent permettre aux GAL d’appliquer le principe de proportionnalité dans leurs décisions. La façon dont les critères sont élaborés et mis en œuvre peut donner la possibilité aux GAL d’ajuster la mise en œuvre de leur stratégie de développement local selon les priorités. Par exemple, dans le cas de plus petits projets, il est possible que les GAL souhaitent abaisser le seuil, modifier l’ensemble de critères ou en introduire un différent. Les coefficients attribués aux différents critères de sélection peuvent aussi varier selon l’ampleur ou le type de proposition, par exemple en ce qui concerne le nombre de preuves exigées pour les petites propositions. La proportionnalité peut aussi être abordée dans la manière d’appliquer les critères, par exemple le degré de précision ou de flexibilité associé aux critères et à leur application.
Lors de l’élaboration de leurs critères de sélection, les GAL doivent prendre en compte la manière dont ils seront appliqués, à savoir la manière dont les avis seront émis lors de la prise de décision. Les approches courantes consistent à noter les projets par rapport à des listes de points à vérifier ou dans des matrices, ce qui suppose pour les GAL de déterminer une valeur par rapport aux critères. Afin de disposer d’une base solide pour justifier les décisions, les critères qui serviront à évaluer les propositions doivent être élaborés avec le plus grand soin.
Par conséquent, lors de l’élaboration de leurs critères, les GAL doivent tenir compte de :
Un grand nombre de points clés concernant la sélection des projets, les objectifs, les principes, les organismes et les personnes qui y participent sont énoncés dans les sections précédentes de ce document. La présente section aborde certains points spécifiques supplémentaires relatifs à la sélection des projets et renforce quelques-uns des points vus précédemment.
L’apport d’informations, aussi précieuses et nombreuses soient-elles, ne suffit pas toujours à engendrer des projets stratégiques solides. Cet aspect du processus LEADER requiert une gestion efficace, stratégique et proactive afin que des projets de bonne qualité puissent prendre forme.
Les documents doivent être conçus de manière à aider les candidats potentiels à comprendre les objectifs de la stratégie de développement local, le processus et les critères qui seront appliqués. Les employés responsables de l’animation et du soutien à l’élaboration de projets doivent veiller à ce que ces procédures et critères soient bien compris.
Veiller à la transparence de la procédure de candidature est absolument capital pour entretenir la motivation et la confiance des acteurs locaux. C’est pourquoi les mécanismes de gestion de la stratégie de développement local doivent définir explicitement les critères de sélection et le processus de mise en œuvre de ces derniers. Ces procédures et ces critères doivent être très clairement définis dans les documents de candidature et tout autre support promotionnel qui y est lié.
Si les procédures sont importantes en soi, leur mise en pratique l’est tout autant. Il est essentiel que les GAL tiennent leurs promesses et qu’ils en informent clairement les candidats. Des commentaires constructifs sont importants pour les promoteurs de projets afin de leur permettre d’améliorer ou de modifier leurs propositions ou de comprendre pourquoi un autre programme ou une autre approche pourrait mieux convenir que LEADER. L’application d’un processus de candidature en deux temps est une approche importante à envisager ici.
Les critères de sélection peuvent être appliqués à tout moment du processus. Ils représentent un élément clé du processus d’animation, de présélection, d’élaboration et de sélection du projet, et participent au processus d’élaboration de la stratégie de développement local. Ils sont un lien essentiel entre les actions des projets et la stratégie de développement local, entre les besoins qu’elle cherche à satisfaire et les résultats attendus. Ils offrent aux GAL un outil de gestion clé pour piloter la mise en œuvre et la réalisation de leur stratégie. Par conséquent, il est essentiel qu’ils ne soient pas uniquement utilisés par les GAL lors de leur prise de décision, mais aussi par les candidats et le personnel des GAL tout au long du processus.
Au bout du compte, c’est à partir de ces critères qu’il sera décidé des projets à financer et, dans de nombreux cas, du montant de cette aide. Les GAL utilisant une variété de processus décisionnels, les critères sont appliqués de différentes manières. Certains GAL votent ou attribuent des notes qu’ils rassemblent dans une matrice ou un tableau ; d’autres discutent du projet à la lumière des critères et parviennent à un consensus. Dans certains cas, cette analyse par rapport aux critères donne lieu à la formulation de recommandations ou de conditions à appliquer avant l’attribution du financement.
Quel que soit le processus décisionnel employé, il doit être consigné afin d’offrir des preuves vérifiables justifiant la décision. Ces preuves doivent montrer que les critères de sélection du projet ont été appliqués d’une manière claire, reproductible et cohérente, et que les procédures spécifiques, notamment celles relatives aux conflits d’intérêts ou au quorum décisionnel du GAL, ont bien été suivies.
En intégrant l’élaboration des critères de sélection dans l’ensemble du processus de mise en œuvre de la stratégie de développement local, et en la reliant aux objectifs et aux indicateurs, la capacité des GAL à suivre l’avancement de chacun des projets et leur contribution à la SDL en est renforcée. Le GAL dispose ainsi d’une base pour l’examen continu de l’avancement de la stratégie de développement local, et le cas échéant, justifier la modification des critères afin de répondre à l’évolution des besoins et de la mise en œuvre, et ce d’une manière transparente.
Le processus d’évaluation des projets du GAL doit comporter l’un ou l’autre type de système de classement structuré qui prend en compte leurs aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Le GAL peut utiliser ce système pour juger de la valeur des propositions par rapport à des seuils ou s’en servir pour des classements et comparaisons. Une méthode très répandue consiste à attribuer des points pour chaque critère de sélection, c.-à-d. classer le projet selon la mesure avec laquelle il met en œuvre ou atteint chaque critère. L’attribution de points peut être confiée au personnel, et être ensuite discutée et confirmée par le conseil d’administration ou le sous-comité d’évaluation des projets, ou directement par leurs membres (ce qui est souvent le cas). Ce type d’approche peut s’imposer davantage lors des stades ultérieurs de la période de programmation, quand les moyens deviennent plus difficiles à obtenir et que les seuils d’approbation sont relevés par nécessité.
De nombreux GAL gèrent des appels permanents à propositions de projets et un processus continu (parfois mensuel) d’évaluation et de prise de décision pour les projets. Cela rend difficile la comparaison qualitative des candidatures entre les différentes réunions d’évaluation. L’organisation d’appels à propositions thématiques peut en partie remédier à ce problème, notamment dans les domaines où les moyens sont limités et où seuls quelques projets sont possibles pendant toute la période de programmation ou plus tard dans la période de mise en œuvre, par exemple après un réexamen de la stratégie de développement local.
Si de nombreuses propositions de projets sont séduisantes sur le papier, il arrive que leurs auteurs ou les organisations candidates s’avèrent tout bonnement incapables de les mettre en œuvre. Il incombe au personnel du GAL de se renseigner sur le profil des candidats, de mener une simple analyse de faisabilité ou des risques et d’en rendre compte au conseil d'administration du GAL afin de lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Les éléments suivants valent la peine d’être vérifiés et peuvent être exigés comme pièces jointes à la proposition de projet :
Pour soutenir l’innovation, il faut avoir un processus de prise de décision capable d'assumer des risques. Parfois, les meilleures idées surgissent de façon tout à fait inattendue, et personne n’aurait pu les imaginer auparavant. Les stratégies LEADER et les processus qui y sont liés doivent faire preuve de suffisamment de souplesse pour inclure les idées de projets les plus innovantes, en ayant évidemment vérifié au préalable leur conformité juridique avec le programme de développement rural du pays.
Exemple de Finlande : un formulaire d’évaluation de projet utilisé par le GAL Joutsenten Reitti
Il est crucial de faciliter la transition entre l’idée du projet, sa sélection et sa mise en marche. Conscients de cette nécessité, les GAL dynamiques alimentent de tels projets, améliorent leur alignement ou adéquation par rapport à la stratégie de développement local et garantissent leur réalisme et leur viabilité. Tout bon projet a besoin de temps pour se développer, une donnée que les GAL doivent intégrer dans leurs processus d’animation, de candidature et de prise de décision s’ils veulent assurer la réussite des projets de haute valeur.
Une fois qu’un projet LEADER a été approuvé par le conseil d’administration du GAL, il ne doit pas être livré à lui-même durant sa mise en œuvre. L’accompagnement du projet et de ses exécutants, mais aussi le soutien du projet, depuis sa première idée jusqu’à la dernière demande de paiement, constituent la mission principale du GAL.
Aussitôt le projet approuvé, de nombreux GAL envoient un dossier d’information aux exécutants du projet sur les tâches quotidiennes de gestion du projet. Ce dossier peut se présenter sous la forme d’un classeur afin de faciliter l’archivage du projet, avec des intercalaires précisant les informations et les documents nécessaires à rassembler et à conserver en vue d’un éventuel audit par les autorités.
Un personnel de GAL à la hauteur assiste aux réunions de projets aussi souvent que possible. La plus importante est la réunion de démarrage, où l’on décide, par exemple, des procédures financières du projet. C’est en étant présent à ces réunions et en expliquant les conditions de financement LEADER que le personnel du GAL peut le mieux éviter au candidat de commettre des erreurs dans la gestion du projet. Il est également utile que le personnel du GAL soit facilement joignable par téléphone ou par e-mail entre les réunions pour répondre à toute question urgente que peuvent se poser les exécutants du projet.
Une série de lignes directrices et de rapports traitent du suivi et de l’évaluation sous LEADER. Voici les références de quelques-uns d’entre eux que vous pourriez trouver utiles.